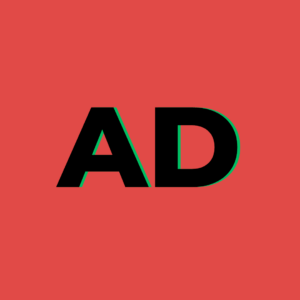Qu’importe la pureté des motivations, nous dit l’utilitarisme, seule compte l’ampleur du bien-être produit. Ainsi, une infidélité tue dans l’œuf la douleur qu’une révélation occasionnerait ? Elle est alors moralement justifiée. Un tramway fou menace trois vies et l’on peut sauver ces innocents en sacrifiant son conducteur ? Que la balance penche du côté du plus grand nombre ! Mais à force de ne voir dans chaque acte qu’un calcul d’intérêt général, ne risque-t-on pas d’éroder les principes fondamentaux qui fondent la morale elle-même ?
Une action est jugée juste non par sa vertu intrinsèque, mais par son aptitude à maximiser le bien-être collectif.
Le labyrinthe des plaisirs et des peines
Bentham, pionnier de cette quête d’objectivité morale, va jusqu’à proposer une échelle de mesure du bien et du mal : un calcul rigoureux basé sur sept critères. L’intensité d’un plaisir, sa durée, sa certitude, son étendue ou encore sa pureté sont ainsi disséqués pour évaluer l’utilité d’une action. Par cette approche, la morale devient une science, une équation que l’on pourrait résoudre avec la froideur d’un arithméticien.
Mais une telle vision ne frôle-t-elle pas l’illusion ? Car si le bonheur collectif pouvait se peser, s’évaluer, se projeter avec exactitude, alors le monde serait un immense échiquier où chaque mouvement serait optimisé pour maximiser le bien-être global. Or, l’existence échappe aux certitudes d’un tableau comptable. Comment quantifier la douleur d’un mensonge, la dignité sacrifiée dans un compromis moral, ou l’incommensurable poids de certaines décisions ?
L’ombre de Kant : quand les principes s’opposent aux chiffres
C’est là que se dresse, en face de Bentham, la figure implacable d’Emmanuel Kant. Pour lui, l’éthique n’est pas une balance de coûts et de bénéfices, mais un ensemble de principes intangibles, des impératifs catégoriques qui transcendent les circonstances. Mentir, tuer, manipuler sont des actes condamnables en soi, indépendamment des bénéfices qu’ils pourraient engendrer. La morale n’est pas une question de résultats, mais de devoirs.
L’affrontement entre ces deux perspectives semble éternel. D’un côté, une morale qui se veut pragmatique, attentive aux conséquences, soucieuse du bien commun, quitte à accepter certaines zones d’ombre. De l’autre, une morale rigide, absolue, qui ne transige pas avec les principes, quitte à en assumer les conséquences les plus rudes.
L’esprit vacille devant cette alternative. Devons-nous privilégier le bonheur du plus grand nombre, même si cela implique quelques renoncements moraux ? Ou devons-nous préserver l’intégrité des principes, même si cela engendre davantage de souffrance ? Entre Bentham et Kant, entre la recherche du bien-être collectif et l’exigence du devoir, l’humanité oscille, hésitante, et poursuit sa quête sans fin.
Sous les cieux londoniens : l’éveil d’un philosophe éclairé
Né le 15 février 1748 à Londres, Jeremy Bentham grandit dans une famille aisée et cultivée. Enfant prodige, il déchiffre le latin dès l’âge de trois ans et s’immerge dans les sonates de Händel à sept ans. Ses études au Queen’s College d’Oxford le destinent au droit, mais il se détourne rapidement de la pratique juridique, rebuté par la complexité du système anglais qu’il qualifie de « démon de la chicane ». Animé par une soif de réforme, il s’attèle à repenser les fondements de la morale et du droit. Son œuvre maîtresse, « Introduction to the Principles of Morals and Legislation » (1789), pose les jalons de l’utilitarisme, prônant le « plus grand bonheur du plus grand nombre » comme boussole éthique. Bentham s’illustre également par son projet de « Panoptique », une prison idéale permettant une surveillance omniprésente, symbolisant sa quête d’efficacité sociale.
Les vents contraires : échos et dissidences face à l’utilitarisme naissant
L’ascension de l’utilitarisme au XVIIIᵉ siècle ne se fit pas sans heurts. Des voix s’élevèrent, dénonçant une vision réductrice de la moralité. Les critiques pointaient du doigt l’indifférence de cette doctrine aux intentions, légitimant potentiellement des actes immoraux si le bonheur collectif en était accru. Cette approche, assimilée à une froide équation coût-bénéfice, semblait ignorer les principes de justice et le respect des droits individuels. De plus, la complexité des interactions humaines, influencées par des facteurs émotionnels, culturels et contextuels, échappait souvent à cette simplification rationnelle. Des penseurs comme Emmanuel Kant proposèrent une éthique déontologique, centrée sur le devoir et les intentions, offrant une alternative à l’approche conséquentialiste de Bentham.
Le fleuve du temps : l’utilitarisme au prisme des réflexions contemporaines
Au fil des siècles, l’utilitarisme a évolué, s’adaptant aux défis de chaque époque. Au XXᵉ siècle, des philosophes comme John Rawls ont critiqué l’aspect sacrificiel de l’utilitarisme, arguant que la quête du bonheur collectif ne devait pas se faire au détriment des droits fondamentaux de certains individus. Parallèlement, des penseurs tels que Peter Singer ont élargi le champ de l’utilitarisme en y intégrant la considération des animaux, plaidant pour une éthique plus inclusive. Aujourd’hui, face aux enjeux globaux tels que la crise climatique et les avancées technologiques, l’utilitarisme continue d’être interrogé et réinventé, témoignant de sa capacité à susciter le débat et à éclairer notre quête incessante d’une société plus juste.